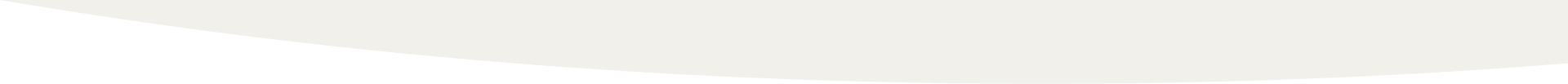Le rôle et le fonctionnement de l’inconscient parental et familial (dimension transgénérationnelle) au niveau du désir d’enfant, de la conception, de la grossesse et de la naissance, et son influence sur le devenir de l’enfant.
Le désir d’enfant
L’évolution du rôle de la femme dans la société ainsi que les progrès médicaux ont fait évoluer le concept de « désir d’enfant ». Citons l’exemple de la contraception apparue dans les années 70. Cela a permis aux femmes de programmer leur grossesse par le choix conscient d’arrêter la contraception.[1] En outre, notre société a fait émerger certaines valeurs peu propices à la nature biologique de la femme et des valeurs familiales, incitant à vouloir contrôler la naissance d’un enfant, choisir le moment opportun pour avoir l’illusion de maitriser le déroulement des événements dans un environnement de plus en plus imprévisible. La société ajoute une pression de responsabilité à ce choix de désirer un enfant qu’il faut assumer à présent. Un point important également relevé par M. Bydlowski est la différence entre le désir de grossesse et d’enfant. L’origine du désir d’enfant remonte à la petite-enfance, vers 2-3 ans. Ce désir a été refoulé ou a subi un mécanisme de sublimation et est ravivé à l’étape œdipienne de l’adolescence : « A cette étape, désirer un enfant signifie désirer remplacer la mère en tant que mère et en tant que femme ».[2] Il est important que la relation de tendresse avec la mère soit maintenue durant la période d’adolescence pour que le désir d’enfant ne soit pas avorté. Toutefois, il est important que la mère assume son rôle de femme séductrice auprès du père pour permettre à la fille de se tourner vers lui et éviter ainsi un lien homosexuel inconscient entre elle et sa fille au risque de ne plus désirer d’enfant. La réalisation du désir d’enfant réactive des conflits avec les figures parentales : « En enfantant, une femme rencontre sa propre mère et vient à son contact, elle la devient, la prolonge en se différenciant d’elle ».[3] Le désir d’enfant s’accompagne de fantasmes sur les représentations de l’enfant auprès des parents pouvant se retrouver dans l’organisation de la vie mentale de l’enfant. S. Lebovici différencie « l’enfant fantasmatique » et « l’enfant imaginaire ». Des troubles psychiques résultant de la confrontation entre l’enfant imaginaire et fantasmatique à l’enfant réel peuvent survenir. Une autre composante du désir d’enfant est celle de la dette de vie. « Le don de la vie, à la fois promesse d’immortalité et de mort, induirait qu’une dette circule de mère à fille».[4] Cette dette symbolique est en jeu lors de la naissance d’un premier enfant. En outre, un processus d’identification à une « mère suffisamment faible » est nécessaire pour pouvoir concevoir un enfant qui viendra sceller la dette de vie entre les deux femmes à travers les générations. Durant la grossesse, la future mère vit une période psychique particulière, défini notamment par une grande sensibilité et une certaine accessibilité à son inconscient grâce à une libération partielle du refoulement. M. Bydlowski décrit ce moment privilégié comme une « transparence psychique ». D. Winnicott considérait cet état transitoire comme psychotique. La transparence psychique au cours de la grossesse permet à la future mère de retrouver l’enfant qu’elle a été. La mère transmet son inconscient à son enfant à travers des représentations psychiques transposées par des gestes et des comportements traduisant ses émotions et influençant le développement psychique de l’enfant. Selon la théorie de l’attachement de J. Bowlby, il y aurait une continuité entre la qualité de l’attachement et la capacité à prendre soin.[5] Il y a donc une dimension transgénérationnelle de l’attachement. La maternité relève du processus d’attachement et de la « préoccupation maternelle primaire » développé par D. Winnicott.[6] La préoccupation maternelle primaire est une période particulière dans les semaines avant et après l’accouchement. Selon D. Winnicott, La mère montre qu’elle est « capable de s’adapter aux premiers besoins du nouveau-né avec délicatesse et sensibilité ».[7] C’est une identification régressive de la mère à son bébé.
Le rôle du père
Le rôle du père, (mais aussi celui de la mère), peut différer de manière très significative d’une culture à l’autre et en fonction des traditions. Selon G. Delaisi De Parseval, notre société véhicule une idéologie féminine sur la conception et la naissance d’un bébé et privilégie la relation mère-enfant durant les premières années. Le père joue généralement un rôle de soutien émotionnel pour la mère. Il lui assure protection et bien-être et contribue ainsi au bon déroulement de la grossesse. Selon F. Dolto, le père est le représentant de la loi sociale, et du fait de son rôle castrateur et séparateur, il promeut l’individuation à l’enfant lui assurant un équilibre et empêchant une relation fusionnelle avec la mère. « Le père va transmettre son patronyme et son histoire».[8] Le désir du père d’avoir un enfant diffère du désir de la mère : « Il s’agit de devenir un père comme les hommes de la famille et en particulier comme son propre père avant lui ».[9] L’échographie est importante pour le père puisqu’il est privé de l’expérience sensorielle directe que bénéficie la mère. Durant la grossesse de sa compagne, le père traversera des bouleversements conscients et inconscients mais ce point est largement passé sous silence dans notre culture occidentale car après-tout, « l’étape de la grossesse est emblématique de son incapacité anatomique à porter l’enfant au-dedans de lui ».[10] Selon M. Bydlowski, la réaction du père face à son désir d’enfant peut prendre différentes formes, à l’instar de la prise de distance et la conquête d’investissements extérieurs. Dans ce cas, le père considère que le désir d’enfant n’est que celui de sa compagne. Selon G. Delaisi De Parseval, le père peut développer des comportements névrotiques et immatures, les trois F : « fight, flight, fear », pouvant accroître l’anxiété de sa compagne. L’enfant peut être impacté par les états émotionnels de sa mère découlant de ces « psychoses de la paternité » ou « folies paternelles »[11]. Un autre comportement observé est le syndrome de « couvade ». Le père mime sa compagne en s’identifiant à elle. Ce syndrome fait référence à un rite ancien où le père se déclare malade et s’alite pendant quelques jours après l’accouchement. Le rôle et l’image du père évoluent parallèlement à l’évolution de notre société qui prône actuellement l’égalité des sexes.
L’inconscient familial et collectif
En ce qui concerne l’inconscient familial et collectif, S. Freud et de nombreux psychanalystes et neurologues après lui ont émis l’hypothèse que le fœtus communiquait avec sa mère, et son père également, pendant la grossesse. A. Ancelin-Schützenberger pense que l’inconscient de la mère est lié à l’inconscient de l’enfant dès la vie utérine. Dès le 7ème mois, l’enfant pourrait partager les rêves de sa mère et donc toutes les images de l’inconscient maternel et familial peuvent impacter la mémoire de l’enfant in utero. Les désirs et projections conscients et inconscients des parents, mais aussi de la famille, vont influencer le développement psychique de l’enfant qui aura l’empreinte de l’histoire parentale et familiale des deux parents. Citons l’exemple du choix du prénom. Celui-ci est chargé des désirs inconscients des parents qui aura pour fonction de restaurer une histoire familiale dont l’enfant devra porter toute sa vie de manière inconsciente. A. Ancelin-Schützenberger parle du « syndrome anniversaire » dans lequel des dates anniversaires de naissance ou de mort, des lieux d’accident, des maladies font écho à un secret de famille, « comme s’il y avait complicité entre l’inconscient de la mère et le préconscient de son enfant à naître, pour que ces dates de naissance deviennent signifiantes ».[12]
Les loyautés invisibles
Ancelin-Schützenberger explique que ce qui n’a pas pu se mettre en larmes et en mots s’exprime ensuite par des maux, faute de mots pour les dire. Elle parle de « loyauté familiale invisible » [13] qui pousse les descendants à répéter le « traumatisme originel »: « Selon cette approche, l’inconscient cacherait un grand livre de comptes. En cherchant à retrouver un équilibre perdu après un traumatisme, il amènerait toute une lignée à respecter les loyautés invisibles ». A. Ancelin-Schützenberger explique également la différence entre deux niveaux de transmission : l’intergénérationnel et le transgénérationnel.[14] L’intergénérationnel est la transmission consciente entre les générations. Alors que le transgénérationnel inclus tous les non-dits, les secrets, les informulés, un deuil non résolu transmis de manière inconsciente aux générations suivantes. S. Tisseron parle de « clivage » lorsqu’une personne décide d’oublier pour survivre. Ce clivage est la principale source des secrets de famille. Ces secrets « suintent » et « ricochent » sur les enfants du porteur de secret. L’enfant est confronté à des comportements et/ou des mots de ses parents qui sont parfois incompréhensibles pour celui-ci. L’enfant est « amener à oublier très vite ce qu’il a vu, entendu et imaginé, et il risque d’orienter plus tard ses goûts et ses comportements en fonction de ce fantôme[15]sans pour autant garder le souvenir des situations autour desquelles il l’a constitué ».[16]
Importance du contexte
Il est également important de considérer le contexte historique, politique, économique, social, et même encore le contexte moral et culturel pour analyser le désir d’enfant et son influence sur son devenir. A. Ancelin-Schützenberger fait référence à la « psychohistoire » dans lequel le destin individuel s’entremêle toujours avec des destins collectifs. Cependant, notre société se concentre plutôt sur l’avenir, notamment à cause des progrès techniques, et nous sommes de plus en plus individualistes. Ceci entraîne indéniablement la rupture progressive de l’inconscient familial et collectif. En reniant notre passé, nos origines et notre famille, nous, ainsi que nos descendants, nous exposons à de lourdes pathologies et/ou maladies.
[1] Bydlowski M., Les enfants du désir, Odile Jacob, mai 2008
[2] Bydlowski M., Les enfants du désir, Odile Jacob, mai 2008. 20,2%
[3] Bydlowski M., Devenir mère, Odile Jacob, novembre 2020. p.22
[4] Bydlowski M., La dette de vie, PUF 2008. 77,2%
[5] Pillet V., La théorie de l’attachement : pour le meilleur et pour le pire,https://www.cairn.info/revue-dialogue-2007-1-page-7.htm, consulté le 19 décembre 2022
[6] Bydlowsky M., Golse B, De la transparence psychique à la préoccupation maternelle primaire. Une voie de l’objectalisation, https://www.cairn.info/revue-le-carnet-psy-2001-3-page-30.htm, consulté le 19 décembre 2022
[7] Bydlowsky M., Golse B, De la transparence psychique à la préoccupation maternelle primaire. Une voie de l’objectalisation, https://www.cairn.info/revue-le-carnet-psy-2001-3-page-30.htm, consulté le 19 décembre 2022
[8] Bydlowski M., La dette de vie, PUF 2015. 52,1%
[9] Bydlowski M., Devenir mère, Odile Jacob, novembre 2020. p.12
[10] Bydlowski M., Devenir mère, Odile Jacob, novembre 2020. p.12
[11] Delaisi De Parseval G., La part du père, Seuil Sciences humaines (H.C.), 24 Octobre 2017
[12] Ancelin-Schützenberger A., Aïe, mes aïeux, Desclée de Brouwer, 1993, Le syndrome d’anniversaire. 27,6%
[13] Concept développé par le psychiatre Ivan Böszörményi-Nagy
[14] Ancelin-Schützenberger A., Psychogénéalogie, Payot & Rivages, 2007, 2012, 2015
[15] Concept repris de la théorie de Maria Torök et Nicolas Abraham
[16] Tisseron S., Secret de famille, PUF 2019. 23,5%