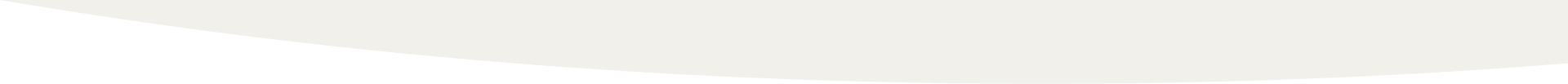« Que se passe-t-il quand un analyste propose la « mise », la mise en acte dans le champ de l’analyse, de la relation sexuelle, à une personne en analyse avec lui ? »[29]
Selon M. Lauret, lorsqu’un patient succombe à la tentation d’aimer son analyste et passe à l’acte sexuel, il se retrouve confronté à un conflit psychologique complexe. La mise en acte équivaut à un inceste dans la réalité psychique de l’analysant ! L. de Urtubey parle d’équivalent de traumatisme infantile pour l’analysant dans son livre « Si l’analyste passe à l’acte ». [30]
L’idéalisation que l’analysant éprouve envers son analyste, appelée « amour de transfert » par S. Freud, joue un rôle essentiel dans la névrose de transfert et permet le travail analytique lui-même. M. Lauret ajoute que le phénomène du transfert est bien plus complexe qu’il n’y paraît, dépassant la simple notion de transfert/contre-transfert établie par S. Freud.
J. Lacan a mis en avant le désir de l’analyste comme pivot du transfert, en le considérant comme un désir d’analyste, soulevant ainsi la question de la possible perversion de la situation analytique. Selon Lacan, « le désir de l’analyste, c’est son énonciation ».
M. Lauret explique[31] que la règle fondamentale de l’analyse stipule que l’amour contre-transférentiel de l’analyste ne doit pas répondre à l’amour de transfert de l’analysant.
S. Freud a établi cette interdiction en indiquant que si cela se produisait, la situation analytique devrait être interrompue: « Il est interdit à l’analyste de céder ». S. Freud craignait fortement une disqualification générale de la profession et la destruction interne de la psychanalyse en attirant des praticiens à l’esprit troublé, ainsi que la ruine de sa réputation de l’extérieur. Toute psychanalyse doit reposer sur un accord tacite : l’analyste s’engage à rester dans son rôle et à ne pas abuser de son patient, même si celui-ci déploie tous ses attraits séduisants dans le cadre de son fantasme, facilité par l’établissement du transfert. Le patient doit être assuré de pouvoir poursuivre intégralement sa thérapie, de bout en bout, en toute confiance. Dans cette dimension éthique, des idéaux analytiques se manifestent.
J. Lacan en a identifié trois[32] : le premier idéal est celui de l’amour humain : l’analyse a apporté un changement de perspective majeur en plaçant l’amour au cœur de l’expérience éthique. Le deuxième idéal est celui de l’authenticité : l’analyse est une technique de démasquage qui exige d’être présent dans toute l’expérience, y compris dans les échecs. Le troisième idéal est celui de la non-dépendance: l’analyse constitue une sorte de prévention contre la dépendance. Ne plus dépendre d’un maître, ne plus être sous l’emprise du transfert sont des objectifs inévitables. Cependant, cela ne semble pas toujours évident à atteindre.
Comme l’explique M. Lauret[33], il relève de la responsabilité de l’analyste de faire un travail sur lui-même et d’être supervisé tout au long de sa carrière professionnelle. Ceci est une question fondamentale de l’éthique en psychanalyse.
Du côté du superviseur, L. Grinberg explique[34] que la supervision est une source de stimulation pour le superviseur car elle lui présente un nouveau terrain et un matériel qu’il ne connaît pas. Cela le pousse à réfléchir, à apprendre, à envisager de nouveaux cadres théoriques et à les ajuster. Il assiste à une redécouverte constante de l’inconscient, en observant attentivement les phénomènes du transfert, du contre-transfert et de la contre-identification projective, ce qui l’incite à remettre en question ses propres idées.
[29] Lauret M., Les accidents du transfert. De Freud à Lacan, Champ Social Éditions, 2013. 3%
[30] De Urtubey L., Si l’analyste passe à l’acte, PUF, 2015
[31] Lauret M., Les accidents du transfert. De Freud à Lacan, Champ Social Éditions, 2013
[32] Lauret M., Les accidents du transfert. De Freud à Lacan, Champ Social Éditions, 2013. 87%
[33] Lauret M., Éthique psychanalytique et accidents du transfert (Psychanalyse et lien social), L’Harmattan, 2022
[34] Grinberg L., Qui a peur du (conte-)transfert, Ithaque, 2018. p88